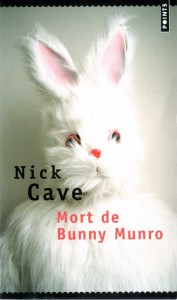A propos de Nick Cave, Mercy on me : 3 questions à Reinhard KLEIST
Après Johnny Cash, Nick Cave. Entre les deux, il y a une sorte de filiation. C’est le côté sombre et complexe de ces musiciens qui t’attirent ?
La raison principale est le sens de la narration de ces artistes dans leur musique et les visuels qu’ils créent avec leur musique et leurs paroles. Je suis vraiment fasciné par la façon dont ils utilisent la musique pour peindre l’humeur de leurs paroles comme un illustrateur. Et évidemment je suis attiré par leur vision sombre du monde et de l’existence humaine. En plus, ils font tous les deux de très bons personnages de bandes dessinées grâce à leur look. Notamment Cave qui est un parfait personnage de bandes dessinées. On peut le faire jouer dans beaucoup de rôles issus de ses propres paroles, histoires et romans.
La grande originalité de ce biopic tient au fait qu’il utilise de façon très personnelle les chansons de Nick Cave pour illustrer son univers. Quels ont été tes critères de choix pour ces chansons ?
Tout d’abord, j’ai choisi les chansons qui convenaient pour la mise en place dramatique du livre. Par exemple « Hammer Song » dans le premier chapitre, parce qu’elle décrit sa jeunesse quand il a quitté l’Australie pour aller dans le vaste monde (l’Europe) et s’est d’abord retrouvé le cul par terre. Exactement comme le garçon de ferme dans la chanson. Je vois là un parallèle. Dans le chapitre « Mer cy Seat » j’ai utilisé la chanson pour parler de la relation de l’artiste ou de l’écrivain aux personnages qu’il crée. Dans « Mercy Seat » Cave tue le protagoniste, comme il fait avec beaucoup de ses personnages et le protagoniste confronte Cave à son destin funeste. Cela se réfère à ce que Cave a dit de la création et du rôle d’un artiste. L’artiste devient comme un Dieu dans l’univers qu’il crée. Il peut tout faire avec ses créations. Et Cave peut être un Dieu très violent. J’ai laissé une de ses créations se rebeller contre lui.
cy Seat » j’ai utilisé la chanson pour parler de la relation de l’artiste ou de l’écrivain aux personnages qu’il crée. Dans « Mercy Seat » Cave tue le protagoniste, comme il fait avec beaucoup de ses personnages et le protagoniste confronte Cave à son destin funeste. Cela se réfère à ce que Cave a dit de la création et du rôle d’un artiste. L’artiste devient comme un Dieu dans l’univers qu’il crée. Il peut tout faire avec ses créations. Et Cave peut être un Dieu très violent. J’ai laissé une de ses créations se rebeller contre lui.
La deuxième raison, c’est que ce sont des chansons qui racontent des parties de sa vie, par exemple « Hallelujah » où il décrit son séjour au centre de désintoxication. Mais je n’ai pas utilisé les chansons dans le bon ordre. Comme lorsque j’ai utilisé « Love Letter » dans la scène où il quittait Anita Lane en Australie et se rendait à Londres. Je l’ai fait en sachant qu’il avait écrit la chanson longtemps après. Je voulais montrer le sens universel des chansons.
Nick Cave a post-facé ton livre en validant ton approche et ta prise de liberté avec la réalité pour donner ta propre vision de sa vie et de son œuvre. De quelle manière a-t-il contribué à ton travail ?
Il a participé au projet dès le début. J’ai contacté son management, ils lui ont transmis l’idée et heureusement, il connaissait mon livre sur Johnny Cash et l’avait aimé et il était prêt à s’impliquer dans le projet. Nous nous sommes rencontrés à quelques concerts, je lui ai rendu visite en studio à Londres et nous avons échangé quelques mails et coups de fils. Il m’a incité à pousser la narration dans une direction plus fantastique et mystique plutôt que de relater de soi-disant faits. Il ne m’a pas donné de détails sur sa vie et je ne lui ai pas demandé de le faire. Pour moi, il était beaucoup plus utile d’échanger des idées sur la façon de raconter l’histoire et sur quoi mettre l’accent. En fin de compte, c’est beaucoup plus une réflexion sur le rôle d’un artiste qu’une biographie normale. Je pense qu’il a aimé cela.
Mais je dois dire, dans le contexte de mon livre, qu’il a bien tué Elisa Day.

 Follow
Follow classique, sélection chronologique des faits les plus marquants de la carrière du crooner lugubre, Kleist a opté pour une évocation dont les chansons de Cave constituent le matériau et la toile de fond. Afin que le lecteur ne soit pas complètement perdu, quelques scènes « réelles » encadrent ces morceaux d’anthologie, depuis l’enfance rurale jusqu’à la collaboration avec Warren Ellis en passant par l’épopée laborieuse mais fondatrice de The Birthday Party, premier groupe de Cave avant qu’il ne s’adjoigne les Bad Seeds. Mais c’est bien au travers de ces scènes oniriques illustrant les textes et les personnages inventés par l’esprit torturé de Cave que Kleist le dépeint le mieux et lève une partie du voile sur l’oeuvre d’un artiste hors du commun, insatisfait en recherche permanente. Sans cesse au bord de l’abîme, le poète maudit vacille avant de se redresser et de repousser pour un temps ses délires et ses addictions. Le livre regorge ainsi d’illustrations hallucinantes d’un artiste à la limite de la folie, comme celles, récurrentes, de Cave penché sur sa machine à écrire, les yeux habités d’une lueur de dément, les doigts crispés sur le clavier. Car Cave reste aussi un parolier prodigieux, doublé d’un écrivain dont les romans valent le détour. La dernière allégorie du livre reprend avec brio le mythe du Crossroads et de Robert Johnson. Car c’est bien de damnation dont il est question ici. Les scènes de concert sont également d’une justesse et d’une énergie bluffantes. Que dire de plus sur cette nouvelle réussite de Kleist si ce n’est que l’opus a recueilli la validation de Nick Cave lui-même. Il n’y a plus qu’à se plonger sans hésiter dans le marais de cette musique finalement rédemptrice, si l’on sait garder la tête (et surtout les oreilles) hors de l’eau.
classique, sélection chronologique des faits les plus marquants de la carrière du crooner lugubre, Kleist a opté pour une évocation dont les chansons de Cave constituent le matériau et la toile de fond. Afin que le lecteur ne soit pas complètement perdu, quelques scènes « réelles » encadrent ces morceaux d’anthologie, depuis l’enfance rurale jusqu’à la collaboration avec Warren Ellis en passant par l’épopée laborieuse mais fondatrice de The Birthday Party, premier groupe de Cave avant qu’il ne s’adjoigne les Bad Seeds. Mais c’est bien au travers de ces scènes oniriques illustrant les textes et les personnages inventés par l’esprit torturé de Cave que Kleist le dépeint le mieux et lève une partie du voile sur l’oeuvre d’un artiste hors du commun, insatisfait en recherche permanente. Sans cesse au bord de l’abîme, le poète maudit vacille avant de se redresser et de repousser pour un temps ses délires et ses addictions. Le livre regorge ainsi d’illustrations hallucinantes d’un artiste à la limite de la folie, comme celles, récurrentes, de Cave penché sur sa machine à écrire, les yeux habités d’une lueur de dément, les doigts crispés sur le clavier. Car Cave reste aussi un parolier prodigieux, doublé d’un écrivain dont les romans valent le détour. La dernière allégorie du livre reprend avec brio le mythe du Crossroads et de Robert Johnson. Car c’est bien de damnation dont il est question ici. Les scènes de concert sont également d’une justesse et d’une énergie bluffantes. Que dire de plus sur cette nouvelle réussite de Kleist si ce n’est que l’opus a recueilli la validation de Nick Cave lui-même. Il n’y a plus qu’à se plonger sans hésiter dans le marais de cette musique finalement rédemptrice, si l’on sait garder la tête (et surtout les oreilles) hors de l’eau.