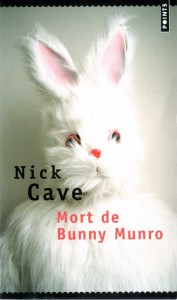Ils étaient bons, parfois géniaux et ils n’ont pas eu le succès qu’ils méritaient. Trop purs, trop bons zicos ? La faute à pas de chance ? Il leur manquait en fait l’essentiel : un tube, ce sésame auquel se résume parfois toute une carrière mais qui rend dérisoire celle qui en est dépourvue
On pourra aussi arguer que leur style, trop original (ou pas assez diront les rabat-joies) ne pouvait être catalogué de manière évidente dans un mouvement, une mode ou une chapelle, ce qui offre à ceux qui en font partie la gloire éternelle dans le sillage des grands prêtres du culte.
Ces Britons se sont contentés de composer d’excellentes chansons. Pas grave au fond, les connaitre permet d’avoir le sentiment d’appartenir à une élite.
Voici donc mon petit hommage perso aux Tommies inconnus au champ d’honneur du Rock.
– Woodentops : Leur musique s’inscrivait dans le courant New-Wave mais ce cocktail de Folk-Rock mâtiné de Punk était en fait inclassable. Qui prétend aimer le Rock anglais se doit de posséder Giant dans sa discothèque. Cet album est somptueux, tout simplement. Rolo Mc Geee était un frontman classieux à la voix chaude et sensuelle. Lors d’une émission des Enfants du Rock, ils avaient mis le feu sur le plateau avec Stop This Car sous le regard éberlué de Phil Manoeuvre. La grande époque. Ci-dessous, une de leurs chansons les plus emblématiques… mais elles le sont toutes.
– Gomez : Sur certains de leurs morceaux, ils ont tutoyé la grâce et ce dès le début de leur carrière avec Rythm and Blues Alibi. Mais après avoir produit de superbes albums, hors du temps, leur Folk-Blues s’est un peu essoufflé et ils ont, comme tant d’autres, mal négocié le virage vers une Pop plus accessible mais encore trop riche musicalement pour que le grand public les suive. Un beau gâchis. Mon album préféré est How We Operate avec son splendide titre éponyme.
– Reef : Découvert par hasard par l’entremise de la série télé anglaise Red Caps, sorte de NCIS britannique, dont un de leurs morceaux Set the Record Straight a été utilisé pour le générique. Un p’tit coup de streaming sur le Net et je découvre trois albums dignes d’éloges. Certes ils ont pas révolutionné le truc mais ils le jouent bougrement bien. Et quelle voix ! Premier morceau du premier album… tout est dit.
– Toy Dolls : Oubliez les Clash, les Sex Pistols, les Dead Kennedys, etc. Le plus grand groupe de Punk, ce sont eux. Pas de message mais du Rock’n Roll à l’état pur dans un esprit festif, clownesque et déjanté, à l’image de leur look et de leurs pochettes de disques. Et quelle énergie sur scène, deux hurluberlus montés sur ressort, un batteur carré et précis, le trio enchaînant à fond les manettes les hymnes de leur Punk épileptique et mine de rien très technique : Olga, le leader, est un guitariste prodigieux alignant avec aisance riffs supersoniques et solis furieux (mais jamais bavards) tout en assurant un improbable chant, aigu et infantile. Ci-dessous une longue vidéo avec tous les titres de leur troisième album. Enjoy…

 Follow
Follow